Jacques Bergier, scribe des miracles... et miracle lui-même !
(Version complète de l'article publié dans la revue Science Frontières, n°36, en novembre 1998)
Prétendre décrire une personnalité aussi complexe, riche et énigmatique que celle de Jacques Bergier en un article est une entreprise bien hasardeuse. Il faut se faire une raison : dans la présente étude, tous les aspects du personnage ne seront pas évoqués. On a souvent rencontré son nom au détour de livres sur les civilisations disparues, sur la parapsychologie, sur l'alchimie, peut-être même dans des anthologies de littérature de science-fiction. Mais on a rarement lu ses livres, pour la bonne et simple raison qu'on les trouve difficilement, et finalement le personnage, le mythe Bergier a souvent pris le pas sur l'homme véritable…
C'est que Jacques Bergier prête facilement à la caricature, ce qui fut d'ailleurs concrétisé par le célèbre papa de Tintin, le dessinateur Hergé, qui le croque sous les traits du professeur Esdanitoff dans son album Vol 714 pour Sydney. Bergier joua d'ailleurs toute sa vie durant sur cette image de personnage haut en couleurs, d'original inclassable, de savanturier à la fois barbouze et enfant, de remueur d'idées saugrenues et d'histoires impossibles.
On cite toujours, lorsqu'on veut cerner le personnage, le texte de ses cartes de visite : « Jacques Bergier, amateur d'insolite et scribe des miracles ». Sur les miracles d'ailleurs, il n'hésitait pas à dire : « Ce qui est vraiment miraculeux au sujet des miracles, c'est qu'ils existent ». Il y a aussi un miracle chez Bergier : son existence même ! Accent cassé, haché, mécanique et certainement pas mélodieux, démarche chaotique et branlante d'enfant maladroit, et visage de professeur Tournesol déjanté, Bergier avait vraiment toute la panoplie du personnage. Jusqu'à son passé de résistant lié à divers réseaux de renseignements, jusqu'à son hypermnésie : sa mémoire fabuleuse qui lui permettait de lire et de retenir en quelques minutes un livre entier, jusqu'à son amitié avec un homme à mille lieux de lui ressembler, voire tout son contraire : Louis Pauwels.
Les années de formation
Jacques Bergier naît en 1912 à Odessa, il est le rejeton d'une famille juive ayant déjà quelques personnages dans sa lignée. Très tôt il développe une faculté de lecture impressionnante, il lit n'importe où, y compris dans les synagogues lors des prières. Mais en 1920, la famille quitte le pays, car l'avenir semble sombre, rythmé par les batailles entre Blancs, Rouges et Verts (anarchistes et paysans)… Toute la famille part donc et finit par atterrir en Pologne, dans la petite ville reculée de Krzemieniec. Bergier y reste jusqu'en 1925, il ne va pas à l'école mais continue à lire de lui-même tout ce qui lui tombe sous la main, avec déjà une préférence pour la littérature de « science-fiction », en même temps qu'un rabbin lui prodigue une éducation religieuse dont il gardera surtout une fascination pour la Cabale, ses mystères et ses légendes.
Mais des problèmes financiers obligent la famille à émigrer encore, et cette fois l'on se dirige vers la France, où l'on retrouve des cousins éloignés à Paris. Une chose le déçoit dès son arrivée : le manque de livres et de bibliothèques ! En quelques années, Bergier s'investit de plus en plus en politique, il participe à des manifestations anarchistes et s'enflamme pour le communisme. Il entre au lycée Saint-Louis et se consacre aux mathématiques. C'est à cette époque qu'il découvre les revues américaines de science-fiction, qu'on trouve alors pour trois sous dans les bacs d'occasion des librairies. Edgar Rice Burroughs, Abraham Merritt et Jack London titillent son imagination, mais ce sont surtout les contes gothiques, fantastiques et vertigineux d'Howard Phillips Lovecraft qui le passionnent. En 1930 il s'inscrit à l'École Supérieure de Chimie, en même temps qu'à la Sorbonne afin de suivre des cours de mathématiques. Il assure ses frais d'études en faisant des traductions de l'anglais et de l'allemand au français, car Bergier développe aussi un remarquable don pour les langues.
Comme il le commente lui-même dans son autobiographie Je ne suis pas une légende : « Peu à peu, les bons livres s'accumulaient dans mon placard, et les idées fantastiques dans ma mémoire. » Et parmi celles-ci, l'idée que l'énergie nucléaire serait un jour maîtrisée par l'humanité. Et celle que l'alchimie, cet art ancien considéré alors comme l'ancêtre maladroit et encombré de mythes de la chimie, pourrait en fait être bien plus que cela, une véritable discipline à la fois scientifique et spirituelle, produisant des résultats tangibles… Bergier rate finalement son diplôme de l'Institut de Chimie mais obtient sa licence en chimie et mathématiques de la Sorbonne.
En 1937 il entre dans l'équipe du laboratoire de chimie physique du professeur Helbronner, savant déjà connu pour ses travaux sur la liquéfaction des gaz, qui lui valurent la médaille d'or de l'Institut Franklin en 1922. Nourri par de longues discussions avec l'irascible Helbronner, Bergier rêve alors de fonder un empire industriel de l'atome, tout en construisant la journée des appareils de laboratoire. Mais il n'oublie pas pour autant que du côté de l'Allemagne, un nouvel homme politique au discours violemment antisémite obtient de plus en plus de suffrages…
L'épreuve du feu
Dès 1935, Bergier s'investit dans la lutte antinazie, en distribuant par exemple des tracs à la sortie des cinémas et des théâtres, lors de voyages d'affaire en Allemagne, avec le soutien du parti communiste allemand. Il ressent évidemment la débâcle française de 1940 comme une grave catastrophe, non seulement pour la civilisation, mais aussi et surtout pour sa propre carrière personnelle : son rêve d'empire financier basé sur l'exploitation de l'atome s'envole irrémédiablement. Dépité mais pas abattu, Bergier décide alors de rester en France pour organiser une résistance. Il voyage à Lyon et à Toulouse, imprime des tracts, prépare et réalise des attentats à la bombe, brûle des archives de la Gestapo, et diffuse même autour de lui un manuel de la guérilla. Enfin, il devient l'un des dirigeants du réseau de résistance Marco Polo, et finit par obtenir la localisation exacte de la base de missiles de Pennemünde, qui sera bombardée par l'armée alliée.
Mais en 1943 il est finalement arrêté par la Gestapo à Lyon. Il ne cède pas à la torture et ne donne aucun nom, on l'envoie alors dans le camp de concentration de Neue Bremme, en Sarre. Il y est placé dans la section « Retour Indésirable ». Mais au grand étonnement de ses tortionnaires et des autres prisonniers, il va survivre aux pires épreuves. Plusieurs fois on le considère comme mort, mais il finit toujours pas sortir du coma. Il résiste notamment à une atroce torture : avec quelques autres prisonniers, on le couche dans la neige, totalement nu, pendant plusieurs heures. Bergier explique qu'il put supporter cette épreuve en se réfugiant dans le monde abstrait des formules mathématiques, effaçant toute autre réalité sur le moment… De même, lorsqu'après seulement 4h de sommeil les gardes sonnent le réveil, Bergier se réfugie mentalement dans le passé pour y récupérer en quelques secondes ses indispensables heures de repos…
En 1944, ce prisonnier récalcitrant qui ne veut décidément pas mourir est transféré au camp de Mauthausen. Une fois installé, il participe à une sorte de résistance interne dont il prend rapidement la tête, aidé de deux autres déportés, le communiste Allemand Franz Dehlem et Gregory Fedorov, futur successeur de Béria en Union Soviétique après la guerre. Le camp de Mauthausen tombe en mai 1945, en grande partie grâce aux préparatifs de ce groupe de résistance.
Après guerre, Bergier devient un conseiller incontournable du gouvernement et traîne du côté des services secrets. Poursuite de criminels de guerre, espionnage et contre-espionnage, recherche de secrets militaires constituent alors son quotidien…
Bergier et l'alchimie
C'est en 1938 que Jacques Bergier s'intéresse pour la première fois à l'alchimie. C'est Helbronner lui-même qui lui en parle et l'emmène rencontrer un employé d'une usine de gaz de la banlieue parisienne : rien moins que le célèbre alchimiste Fulcanelli, auteur des deux livres Le mystère des cathédrales et Les demeures philosophales. Au cours de la discussion, si l'on en croit Bergier, Fulcanelli disserte sur les grands dangers auxquels peut aboutir la recherche atomique. Si l'homme maîtrise l'énergie nucléaire, c'est toute la civilisation qui est menacée d'autodestruction. Cette fameuse discussion est racontée dans Le Matin des Magiciens.
Après guerre, Bergier va lui-même tenter des expériences alchimiques, et prétend avoir pu synthétiser de l'argent et de l'or en petites quantités, mais aussi du béryllium. Le béryllium est l'élément principal de l'émeraude, et Bergier relève (dans son autobiographie) que le texte principal de l'art alchimique n'est autre que… La Table d'Émeraude, du mythique Hermes Trismégiste.
Après la succès du Matin des Magiciens, Bergier entre en contact avec un alchimiste allemand qui lui fournit quelques onces de « poudre de projection ». D'après quelques papiers personnels de Bergier datant de cette époque, la poudre en question fonctionnait parfaitement. Peut-être est-ce le même alchimiste allemand qui signe plus tard le livre L'alchimie, science et sagesse, aux éditions Planète, sous le nom de Titus Burckhardt.
Le Matin des Magiciens et Planète
C'est au milieu des années 50 que Bergier rencontre Louis Pauwels. René Alleau les présente l'un à l'autre. Pauwels cherchait un homme de science capable de l'aider pour la rédaction de certains articles. Les deux hommes n'ont réellement rien en commun. Pauwels est un intellectuel, un littéraire qui a connu une période guénonienne, c'est-à-dire antiprogressiste, alors que Bergier ne jure que par la méthode scientifique, méprisant tout autre attitude face au monde. Mais malgré ces différences une grande amitié naît tout de suite entre eux, au point qu'ils consacrent les cinq années suivantes à la rédaction d'un énorme et inclassable livre, Le Matin des Magiciens, sorti chez Gallimard en 1960. Le Matin des Magiciens marque un véritable tournant dans la vie de Bergier. Il devient soudain très célèbre.
Pas question de résumer ici en quelques lignes ce pavé baroque et érudit qu'est Le Matin des Magiciens, disons simplement que les auteurs y abordent en profondeur des sujets aussi différents que la parapsychologie, les civilisations disparues, les racines occultes du nazisme et l'obscurantisme scientiste du XIXème siècle, dont ils regrettent qu'il n'ait pas disparu avec son siècle.
Quelle est la part de Bergier dans ce livre fameux, qui a connu jusqu'à aujourd'hui une dizaine de rééditions en France ? Si l'on en croit Bergier lui-même, le travail s'organisait selon un rituel bien établi : le soir, les deux amis se réunissaient et discutaient ensemble. Bergier racontait à Pauwels les plus fantastiques histoires et anecdotes, tirées de ses dossiers personnels. Le lendemain matin, Pauwels rédigeait le manuscrit en se basant sur la soirée passée.
C'est dans ce livre que Bergier rapporte son entrevue avec le mystérieux Fulcanelli en 1938. Dans un autre chapitre, il décrit la fameuse expérience de télépathie réalisée par l'armée américaine dans les années 50 à bord du sous-marin Nautilus. En février 1960, avant que le livre ne soit sorti, la revue Science & Vie avait déjà publié un article relatant la même prétendue expérience, sous la plume de Gérard Messadié. On considère aujourd'hui cette rumeur comme totalement infondée, car aucun document officiel américain déclassifié n'en a jamais fait état.
Voilà un des aspects les plus discutables et les plus géniaux de Bergier : citer des faits extraordinaires, en refusant toujours de divulguer ses sources, pour raisons de sécurité. A la suite de ce livre-événement, Pauwels et Bergier, aidés principalement du maquettiste Pierre Chapelot et de Jacques Mousseau, lancent la revue Planète. Il s'agit principalement de combler l'attente des centaines de milliers de lecteurs du livre. Très vite et contre toute attente, la revue obtient un véritable succès, et devient rapidement un phénomène de société. Bergier l'alimente principalement en articles sur les recherches parapsychologiques en URSS et aux USA, ainsi que d'études sur « l'histoire invisible », c'est-à-dire sur les agissements et opérations plus ou moins secrètes de services gouvernementaux.
Bergier et la SF
Jacques Bergier s'est très tôt intéressé à la littérature de science-fiction. Au début des années 30 il découvre les « pulps » américains, que l'on achète alors en occasion à Paris chez Gibert-Joseph. Il devient vite un fan de Howard Philips Lovecraft (1890-1937), et ne tarde pas à entretenir une correspondance avec « le solitaire de Providence ». Successivement paraissent dans la revue Weird Tales deux lettres de Bergier, « From a French reader » en mars 1936, et « From a French enthousiast » en septembre 1937. En 1955 Bergier signe la préface à la traduction française du recueil Démons et merveilles, aux Éditions des Deux Rives. C'est ce même texte quelque peu remanié et développé qui paraît dans le premier numéro de la revue du réalisme fantastique, Planète, en 1961, sous le titre : « Lovecraft, ce grand génie venu d'ailleurs ». La science-fiction n'est pas seulement un loisir pour Bergier, il y voit toute une manière de penser et de comprendre le monde. Pour Bergier la SF, plus qu'une suite de visions rêveuses, est une préfiguration de ce qui attend l'humanité. On peut se rendre compte de l'importance qu'il donne à ce genre littéraire en citant l'extrait d'une courte lettre adressée aux frères Bogdanoff en septembre 1975 : « La SF est le contraire de la littérature. La littérature est faite par des ratés pour des ratés. La SF par contre décrit la victoire. Victoire sur le temps, sur l'espace, sur l'hostilité de l'univers, victoire acquise grâce à la technique. »
La fin du réalisme fantastique
L'aventure du réalisme fantastique s'achève au début des années 70. Les événements de mai 68 ont profondément divisé la rédaction, c'est-à-dire principalement Pauwels, Bergier, Pierre Chapelot, Jacques Mousseau, Gabriel Veraldi, Aimé Michel… Un Nouveau Planète, lancé fin 1968, tiendra 25 numéros sans jamais atteindre le succès du premier Planète. Bergier quitte rapidement la direction de ce Nouveau Planète car il n'apprécie pas la nouvelle politique éditoriale.
En 1970 tout de même, il publie avec Louis Pauwels L'homme éternel, premier tome d'une série de cinq volumes d'un « Manuel d'Embellissement de la Vie ». Bergier attend beaucoup de ce livre, conçu comme un nouveau Matin des Magiciens mieux référencé et plus rigoureux, focalisé sur le thème de l'archéologie mystérieuse et des civilisations disparues. Malheureusement le livre n'a pas le succès qu'espérait Bergier. Pauwels abandonne tout simplement le projet au grand dam de son ami, incapable d'entamer les 4 autres volumes sans l'aide de son partenaire…
La brouille entre les deux créateurs du réalisme fantastique ne cesse plus de grandir, au point qu'ils n'entretiennent pratiquement plus de relations à la mort de Bergier en 1978.
Les livres post - réalisme fantastique
Après la fin du mouvement réaliste fantastique et l'abandon par Pauwels du Manuel d'Embellissement de la Vie, Bergier va écrire ses propres livres de style réaliste fantastique. Il se persuade que la formule d'un petit livre par thème est bien plus intéressante en fin de compte que le gros essai encyclopédique à la manière du Matin des Magiciens. D'autant plus que Bergier est bien conscient de ne pas avoir le talent littéraire de Pauwels.
Vont donc paraître successivement une petite dizaine de livres dont les titres sont aussi maladroits que les contenus sont intéressants…
Les extraterrestres dans l'histoire, 1970
 Bergier y passe en revue plusieurs événements et histoires bien étranges, mais sans jamais cependant affirmer clairement qu'il puisse s'agir de preuves de l'existence d'extraterrestres. Il le suggère souvent, mais simplement comme une hypothèse bien séduisante… Un chapitre est consacré aux traces d'objets métalliques retrouvés lors de fouilles et pouvant indiquer l'existence de civilisations disparues ayant possédé une haute technologie, un autre est consacré à la plaine de Nazca et aux ruines incas, un autre aux cartes de Piri Reis… L'un des chapitres les plus intéressants est certainement « les visiteurs du Moyen-Âge », où Bergier étudie les témoignages d'apparitions « d'êtres lumineux » entre l'an 1000 et le début du XVIème siècle, en se basant sur les textes de Facius Cardan et John Dee par exemple. Bergier y retrace aussi l'histoire du fameux manuscrit codé indéchiffrable de Roger Bacon, ou « Manuscrit Voynich » (du nom de son dernier acquéreur)…
Bergier y passe en revue plusieurs événements et histoires bien étranges, mais sans jamais cependant affirmer clairement qu'il puisse s'agir de preuves de l'existence d'extraterrestres. Il le suggère souvent, mais simplement comme une hypothèse bien séduisante… Un chapitre est consacré aux traces d'objets métalliques retrouvés lors de fouilles et pouvant indiquer l'existence de civilisations disparues ayant possédé une haute technologie, un autre est consacré à la plaine de Nazca et aux ruines incas, un autre aux cartes de Piri Reis… L'un des chapitres les plus intéressants est certainement « les visiteurs du Moyen-Âge », où Bergier étudie les témoignages d'apparitions « d'êtres lumineux » entre l'an 1000 et le début du XVIème siècle, en se basant sur les textes de Facius Cardan et John Dee par exemple. Bergier y retrace aussi l'histoire du fameux manuscrit codé indéchiffrable de Roger Bacon, ou « Manuscrit Voynich » (du nom de son dernier acquéreur)…
Les livres maudits, 1971
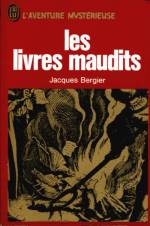 Certainement l'un des livres les plus passionnants de Bergier. Il y développe l'idée d'un groupement secret, qu'il appelle « les Hommes en Noir », dont la tâche serait de faire disparaître tout livre traitant de choses dont l'humanité ne devrait pas être avertie. En fait, cette hasardeuse hypothèse est un beau prétexte pour passer en revue toute une littérature « aberrante », dont on a du mal à savoir si Bergier la prend vraiment au sérieux, ou comme simple objet de fascination.
Certainement l'un des livres les plus passionnants de Bergier. Il y développe l'idée d'un groupement secret, qu'il appelle « les Hommes en Noir », dont la tâche serait de faire disparaître tout livre traitant de choses dont l'humanité ne devrait pas être avertie. En fait, cette hasardeuse hypothèse est un beau prétexte pour passer en revue toute une littérature « aberrante », dont on a du mal à savoir si Bergier la prend vraiment au sérieux, ou comme simple objet de fascination.
Ainsi sont étudiés successivement la légende du livre de Thot, les ouvrages brûlés dans la Bibliothèque d'Alexandrie, les improbables Stances de Dzian, la Stéganographie de l'abbé Trithème, la Monade hiéroglyphique de John Dee, le manuscrit Voynich (dont l'histoire se développe cette fois pendant tout un chapitre), le manuscrit Matthers (et donc l'histoire de la fameuse Golden Dawn), le mystérieux Excalibur, dernier livre qu'aurait écrit Ron Hubbard et qui ne fut jamais publié (à cette occasion, Bergier est un des premiers à s'inquiéter de la montée en puissance de la Scientologie), l'histoire du professeur Russe Filippov retrouvé mort dans son laboratoire en 1903 alors qu'il travaillait sur son dernier livre La révolution par la science ou la fin des guerres. Enfin, Bergier retrace l'histoire d'un ouvrage qui n'a rien de maudit, La double hélice, par le professeur Watson : bien que ce soit aujourd'hui un classique, ce livre fut abondamment décrié à sa sortie, et victime d'une sorte de censure de fait, tout simplement parce qu'il était trop révolutionnaire pour une partie de la communauté scientifique de l'époque. L'intérêt de ce livre se trouve autant dans les ouvrages étudiés, que dans le portrait de personnages hauts en couleurs tels Héléna P. Blavatsky, John Dee ou Samuel Mathers.
Le livre de l'inexplicable, 1972
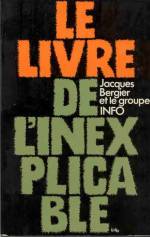 Cette fois Jacques Bergier a travaillé en collaboration avec le groupe américain INFO (INFormations FOrtéennes). Le livre de l'inexplicable est une forme d'hommage et de continuation du travail de l'infatigable Charles Hoy Fort, un des maîtres de Bergier, auteur entre autres du fameux Livre des Damnés (1921). On ne trouve qu'une fois la signature de Bergier parmi toutes les études que contient cette petite encyclopédie de l'étrange, outre les préfaces aux articles. Sous le titre « le miracle de Robozer », Bergier retrace un événement s'étant déroulé en 1663 dans la région de Moscou, et dont les archives d'un monastère orthodoxe ont gardé la mémoire. À lire la description du phénomène, deux boules de lumière ayant « incendié » un lac pendant plusieurs minutes pour finir par disparaître, laissant derrière elles des poissons morts et une couche rougeâtre sur la surface, on ne peut s'empêcher de penser aux histoires modernes d'OVNI plongeant ou sortant des lacs, malgré la mise en garde humoristique de Bergier : « On est prié de ne pas me dire, sous peine de châtiments corporels, que c'est une soucoupe volante qui s'est écrasée à Robozer. »
Cette fois Jacques Bergier a travaillé en collaboration avec le groupe américain INFO (INFormations FOrtéennes). Le livre de l'inexplicable est une forme d'hommage et de continuation du travail de l'infatigable Charles Hoy Fort, un des maîtres de Bergier, auteur entre autres du fameux Livre des Damnés (1921). On ne trouve qu'une fois la signature de Bergier parmi toutes les études que contient cette petite encyclopédie de l'étrange, outre les préfaces aux articles. Sous le titre « le miracle de Robozer », Bergier retrace un événement s'étant déroulé en 1663 dans la région de Moscou, et dont les archives d'un monastère orthodoxe ont gardé la mémoire. À lire la description du phénomène, deux boules de lumière ayant « incendié » un lac pendant plusieurs minutes pour finir par disparaître, laissant derrière elles des poissons morts et une couche rougeâtre sur la surface, on ne peut s'empêcher de penser aux histoires modernes d'OVNI plongeant ou sortant des lacs, malgré la mise en garde humoristique de Bergier : « On est prié de ne pas me dire, sous peine de châtiments corporels, que c'est une soucoupe volante qui s'est écrasée à Robozer. »
Même si Le livre de l'inexplicable est de plutôt bonne facture, force est de constater que Bergier a surtout servi de caution. Le livre est signé de son nom alors qu'il n'a fait sans doute que rassembler et sélectionner les articles des membres du groupe INFO, et rajouter quelques textes pour faire bonne figure. Les articles en question vont d'ailleurs du bon au moins bon. Notons surtout pour tous les amateurs d'OVNI l'article « Étranges lumières dans les colonies américaines de S. M. Britannique au XVIIème siècle », « La clinique lapidée d'Arcachon » pour les amateurs de parapsychologie, et enfin « Le presbytère hanté de Borley » pour se rendre compte que Bergier n'était pas un naïf. Les dernières lignes du livre donnent une idée de l'état d'esprit qui présida à sa rédaction : « Si la négation systématique est aussi nocive pour la recherche que la crédulité la plus naïve, le doute et la méfiance s'imposent. Il faut toujours se méfier, il faut toujours contrôler. 99 cas sur 100 s'effondreront, mais le centième devra être retenu et pourra être utilisé. »
Les maîtres secrets du temps, 1974
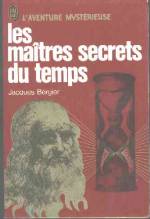 Encore un titre bien vendeur, pour un livre qui est surtout une collection de portraits de personnages historiques rendus fabuleux par le talent de conteur de Bergier. À la base de ce livre, il y a, encore, une hypothèse hasardeuse qu'on ne doit considérer que comme un prétexte, et non comme une affirmation péremptoire. En bref, des personnages qui semblent venir du futur ont vécu dans les siècles passés, et avaient une avance extraordinaire pour leur époque. On peut déjà trouver la même idée dans Le Matin des Magiciens.
Encore un titre bien vendeur, pour un livre qui est surtout une collection de portraits de personnages historiques rendus fabuleux par le talent de conteur de Bergier. À la base de ce livre, il y a, encore, une hypothèse hasardeuse qu'on ne doit considérer que comme un prétexte, et non comme une affirmation péremptoire. En bref, des personnages qui semblent venir du futur ont vécu dans les siècles passés, et avaient une avance extraordinaire pour leur époque. On peut déjà trouver la même idée dans Le Matin des Magiciens.
Une fois cette hypothèse posée (n'oublions pas que Bergier est toujours resté un grand admirateur de Lovecraft), on découvre une galerie de personnages passionnants et énigmatiques. Entre autres le légendaire Fo-Hi, empereur immortel de l'Empire du Milieu, le magicien du XIIIème siècle Michael Scot (qui prétendait notamment qu'il était possible d'en savoir plus sur les motivations des hommes grâce à l'étude de leurs rêves), Leonard de Vinci (et ses manuscrits écrits à l'envers), l'étonnant visionnaire Roger Boscovich et enfin l'excentrique savant Oliver Heaviside et ses « mathématiques symboliques ».
Visa pour une autre terre, 1974
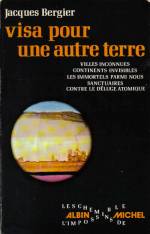 Le sommaire de ce volume laisse rêveur quant aux capacités imaginatives de Bergier : « villes inconnues, continents invisibles, les immortels parmi nous… ». Mais malgré ces accroches, il y est surtout question de « portes induites » menant vers d'autres mondes, puis de l'existence supposée ou avérée de sociétés secrètes, et de leurs buts au sein de l'humanité.
Le sommaire de ce volume laisse rêveur quant aux capacités imaginatives de Bergier : « villes inconnues, continents invisibles, les immortels parmi nous… ». Mais malgré ces accroches, il y est surtout question de « portes induites » menant vers d'autres mondes, puis de l'existence supposée ou avérée de sociétés secrètes, et de leurs buts au sein de l'humanité.
Mais tout le livre est surtout un vaste et passionnant exercice d'imagination. Sur la description de possibles « autres univers », on peut citer ce passage, qui rappellera certainement des souvenirs aux lecteurs de l'astrophysicien Jean-Pierre Petit : « Les enclaves de l'inconnu influencent notre vie. Par leur intermédiaire, nous pouvons influencer d'autres univers et ces univers autres peuvent nous influencer. Le mécanisme est assez semblable à ce qui se passe dans le jeu d'échecs pour un fou pouvant simplement parcourir des cases blanches et un fou adverse ne pouvant parcourir que des cases noires. Ils ne peuvent pas s'influencer directement : c'est exactement la situation de deux univers différents. »
Un autre passage de ce livre mérite d'être cité, car Bergier y précise sa manière d'envisager son sujet : « Comme toutes les idées contenues dans ce livre, je présente (l'idée selon laquelle la Terre puisse être une surface topologique) comme un jeu de l'esprit, une façon d'aller au-delà des frontières ordinaires de notre imagination et de s'élargir les idées. » C'est certainement cette même démarche qui présida à la rédaction des autres livres de cette période post-réalisme fantastique, comme on peut aisément s'en rendre compte à leur lecture.
Enfin, on ne peut passer outre la géniale définition que donne Bergier de l'inconnu, dans une introduction titrée « Le pudding magique » : « Au risque de choquer les philosophes, je dirais que l'image du monde est celle d'un pudding contenant des fruits confits. Dans la grande masse du connu apparaissent soudain des fragments de l'inconnu qui sont impossibles à déloger et qui sont très différents de la structure générale de l'univers. »
La guerre secrète de l'occulte, 1978
Bergier aborde ici le sujet des pouvoirs supposés de l'esprit humain, voyance, télépathie et télékinésie principalement. Mais il ne se contente pas de passer en revue ces « pouvoirs », et consacre surtout beaucoup de chapitres à la manière dont divers gouvernements ont pu s'intéresser, voire utiliser, ces facultés. Bergier ne cessa jamais d'entretenir des relations amicales avec d'anciens de divers services de renseignements ainsi qu'avec des « barbouzes », en France, en URSS et ailleurs. D'où quelques sources d'information bien intéressantes sur ce genre de sujet. Et Bergier reste lucide, malgré son penchant pour les hypothèses fantastiques. Ainsi quelques chapitres sont consacrés aux manipulations de population à l'aide d'éléments « occultes », par exemple le Yi King en Chine (utilisé pour faire la propagande d'adversaires de Mao qui firent circuler la rumeur selon laquelle le Yi King avait annoncé sa chute prochaine), ou l'existence de vampires aux Philippines (rumeur lancée pour maquiller des crimes, sans doute gouvernementaux…). Un chapitre « L'occulte au Pentagone et à la NASA » mérite le détour. Bergier y explique comment on y utilise le « mythe de la soucoupe volante » à des fins d'espionnage ou de contrôle de l'opinion publique. Il faut noter que Bergier resta toute sa vie convaincu que les OVNI n'existaient pas, sans doute parce qu'il considérait que si des extraterrestres avaient croisé notre route (ce qu'il n'était pas loin de penser), ils ne l'auraient pas fait dans de vulgaires casseroles volantes, mais par des moyens bien plus subtils (voir sur le sujet Blumroch l'Admirable ou le déjeuner du surhomme, de Louis Pauwels).
Le livre du mystère, 1978
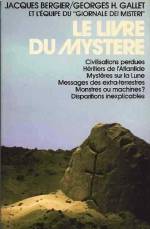 Sur le même principe que pour Le livre de l'inexplicable, Bergier, cette fois aidé de son ami Georges H. Gallet, prête son nom à une compilation d'articles tirés du magazine italien Giornale dei Misteri. Malheureusement, si Le livre de l'inexplicable était réalisé avec rigueur et sérieux, on ne peut pas en dire autant pour ce volume… Le Giornale dei Misteri était une sorte d'Ici Paris de l'étrange, colportant toutes les rumeurs les plus délirantes, sans trop de soucier de vérifier ses sources. Bergier est bien conscient de cette triste réalité, comme il le laisse clairement entendre dans la préface, où il compare les approches du groupe INFO et du Giornale dei Misteri : « On doit bien convenir, sans vouloir blesser le moins du monde nos amis italiens, que la psychologie latine est différente sinon opposée à la psychologie anglo-saxonne. Autant les Américains (…) sont, dans l'ensemble, sceptiques dans leur pragmatisme, autant les Italiens (…) ont tendance, de par leur tempérament chaleureux, à admettre davantage. »
Sur le même principe que pour Le livre de l'inexplicable, Bergier, cette fois aidé de son ami Georges H. Gallet, prête son nom à une compilation d'articles tirés du magazine italien Giornale dei Misteri. Malheureusement, si Le livre de l'inexplicable était réalisé avec rigueur et sérieux, on ne peut pas en dire autant pour ce volume… Le Giornale dei Misteri était une sorte d'Ici Paris de l'étrange, colportant toutes les rumeurs les plus délirantes, sans trop de soucier de vérifier ses sources. Bergier est bien conscient de cette triste réalité, comme il le laisse clairement entendre dans la préface, où il compare les approches du groupe INFO et du Giornale dei Misteri : « On doit bien convenir, sans vouloir blesser le moins du monde nos amis italiens, que la psychologie latine est différente sinon opposée à la psychologie anglo-saxonne. Autant les Américains (…) sont, dans l'ensemble, sceptiques dans leur pragmatisme, autant les Italiens (…) ont tendance, de par leur tempérament chaleureux, à admettre davantage. »
Au final, Le livre du mystère reste une belle compilation d'histoires fabuleuses et de théories improbables, laissant peu de place à des enquêtes plus sérieuses. Tout ce qui porte la marque de l'Ange du Bizarre y est catalogué : monstre du Loch Ness, Yétis, hommes volants, ruines mystérieuses, disparitions inexplicables, momifications étranges, lycantropie… Toute une partie de l'ouvrage est même consacré aux OVNI, de l'affaire des Masques de Plomb aux lettres Ummites, en passant par le Livre d'Enoch et les bizarreries observées lors des missions lunaires américaines ! Un comble lorsqu'on sait que Bergier ne portait aucun crédit à ce dossier…
L'homme Jacques Bergier
Deux livres permettent de mieux cerner l'individu Bergier. Tout d'abord l'hommage que lui rend son ami Louis Pauwels dans Blumroch l'admirable ou le déjeuner du surhomme, puis sa propre autobiographie, Je ne suis pas une légende.
Blumroch l'admirable ou le déjeuner du surhomme, 1976
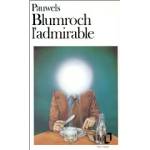 D'après Gabriel Veraldi, biographe de Louis Pauwels, ce livre est « un monument d'amitié ». Pauwels y dresse le portrait cocasse, fabuleux et tendre de son ami Bergier. Sur le principe de la discussion philosophique (à l'instar du Neveu de Rameau de Diderot), on assiste au « déjeuner du surhomme » Joseph Blumroch, c'est-à-dire Bergier lui-même, questionné par Pauwels. Beaucoup de sujets sont abordés, avec une prédominance du thème de l'homme futur, le « mutant », sujet cher à Bergier. Mais ce livre vaut aussi par la description physique et psychologique de Bergier. Son humour ainsi que ses facultés imaginatives y sont admirablement soulignés, et même si les traits sont sans doute un peu exagérés, le portrait reste dans l'ensemble très fidèle. Joseph Blumroch n'est pas tout à fait Jacques Bergier, mais correspond tout à fait en tout cas à l'image qu'il s'était construit de « scribe des miracles » aux histoires incroyables et aux théories vertigineuses.
D'après Gabriel Veraldi, biographe de Louis Pauwels, ce livre est « un monument d'amitié ». Pauwels y dresse le portrait cocasse, fabuleux et tendre de son ami Bergier. Sur le principe de la discussion philosophique (à l'instar du Neveu de Rameau de Diderot), on assiste au « déjeuner du surhomme » Joseph Blumroch, c'est-à-dire Bergier lui-même, questionné par Pauwels. Beaucoup de sujets sont abordés, avec une prédominance du thème de l'homme futur, le « mutant », sujet cher à Bergier. Mais ce livre vaut aussi par la description physique et psychologique de Bergier. Son humour ainsi que ses facultés imaginatives y sont admirablement soulignés, et même si les traits sont sans doute un peu exagérés, le portrait reste dans l'ensemble très fidèle. Joseph Blumroch n'est pas tout à fait Jacques Bergier, mais correspond tout à fait en tout cas à l'image qu'il s'était construit de « scribe des miracles » aux histoires incroyables et aux théories vertigineuses.
Je ne suis pas une légende, 1977
 Toujours d'après Gabriel Veraldi, cette autobiographie de Jacques Bergier mélange « de façon déroutante pour les lecteurs et pénible pour ses amis, la vérité et la fabulation, la sagacité et le délire ».
Toujours d'après Gabriel Veraldi, cette autobiographie de Jacques Bergier mélange « de façon déroutante pour les lecteurs et pénible pour ses amis, la vérité et la fabulation, la sagacité et le délire ».
Reste tout de même une collection d'anecdotes et de souvenirs passionnants pour tout lecteur, en particulier les chapitres consacrés à ses années de résistance puis de prisonnier en camp de concentration. On mesure alors à quel point Bergier pouvait utiliser l'humour comme une arme, lorsqu'il évoque notamment la survie à Mathausen. Un chapitre consacré à « La Très Sainte Alchimie » est à conseiller à tous les amateurs de cette discipline, et le chapitre « La lèpre, c'est très publique » est un véritable festival de l'humour Bergier.
Il faut noter enfin qu'un 19ème chapitre était prévu, consacré aux années Planète. Mais, certainement sous la pression de son entourage, Bergier décida finalement de supprimer cette partie, qui paraît-il était plus qu'outrageante pour les animateurs et les lecteurs de la revue du réalisme fantastique. C'est sans doute à cela que fait allusion Veraldi (compagnon de Pauwels et Bergier lors de l'aventure Planète) lorsqu'il parle de « fabulation » et de « délire »…
Un pamphlet de Jacques Bergier : Le mythe de la girafe.
Voici un texte écrit par Jacques Bergier en 1965 et intitulé « La girafe n'existe pas ». Il s'agit d'une réponse humoristique au livre de l'Union Rationaliste Le Crépuscule des Magiciens, qui attaquait violemment le réalisme fantastique, sa revue Planète et ses principaux acteurs. Contre les attaques souvent très agressives (et débordant largement du cadre strictement scientifique) du livre de l'Union Rationaliste, la rédaction de Planète décida de répondre d'abord par l'humour, et c'est ce qui fut fait dans le n°23 de la revue. On trouve donc entre autres textes (dont une étude de Pauwels démontrant que le cinéma n'est qu'un mythe socio-culturel et n'a aucune existence réelle) cette étude de Jacques Bergier.
LA GIRAFE N'EXISTE PAS
(Texte de Jacques Bergier écrit en 1965)
La science contre les mythes
Pour un esprit bien rompu aux méthodes scientifiques modernes, la vraie démonstration de la non-existence de la girafe réside dans le fait que la girafe n'existe pas. Ce genre de raisonnement est appelé « la méthode de Lavoisier » : on sait que le fondateur de la chimie avait démontré de cette façon l'inexistence des météorites en déclarant « qu'il ne peut pas tomber des pierres du ciel, parce qu'il n'y a pas de pierres dans le ciel ». Dans les temps modernes, cette méthode a été brillamment employée par M. Simon Newcomb qui démontra que les avions ne peuvent pas voler parce qu'un aéronef plus lourd que l'air est impossible et M. Imbert Nergal, qui démontra que les phénomènes parapsychologiques n'existent pas parce qu'il n'y a pas de phénomènes parapsychologiques. D'autres savants ont exercé la même besogne de salubrité, ce qui fait qu'un Américain appelé Charles Fort a pu faire tout un volume, intitulé « Le livre des Damnés », consacré aux faits ainsi expulsés à juste titre du corps de la Science.
Parmi ces faits damnés, la légende de l'animal appelé « girafe » est particulièrement frappante.
Le voyageur arabe Al Kwraismi a, pour la première fois, décrit cette bête mythologique au cou extrêmement allongé. Depuis, de nombreux voyageurs ont prétendu avoir vu ou même photographié des girafes. Et la revue Planète n'a pas hésité, pour abuser ses lecteurs trop confiants, à accréditer ce mythe pernicieux, en dépit des mises en garde du grand savant André Parinaud. Il est donc intéressant d'examiner comment une telle légende peut avoir pris naissance. Plusieurs explications sont possibles :
1 - L'explication optique :
On sait que les déserts, où l'on a signalé des girafes, sont également les lieux de nombreux mirages. Ces mirages sont dus au phénomène d'inversion. Ce phénomène consiste en ceci : pour des raisons bien connues des météorologistes, il arrive qu'une couche d'aire froid se trouve superposée à une couche d'air chaud qui aurait dû se trouver au dessus de la couche d'air froid. La différence de densité des deux couches d'air produit alors une courbure des rayons de lumière et un mirage. Un objet est alors vu à un endroit où il n'est pas, ou sous une forme modifiée. Très fréquemment l'inversion fait apparaître un objet sous une forme allongée comme les miroirs déformants des foires. Il est donc parfaitement admissible qu'un animal tout à fait ordinaire et bien connu, une licorne par exemple, puisse apparaître à l'explorateur sous une forme invraisemblable et allongée et donner ainsi naissance à la légende de la girafe.
2 - L'explication par la soif :
Le mirage qui a donné naissance à la girafe peut également être d'une origine purement psychologique. Perdu dans le désert et assoiffé, l'explorateur peut, dans un état de semi-conscience, rêver qu'il a un cou extrêmement long lui permettant d'atteindre l'oasis la plus proche. Quoi de plus naturel que de le voir aussi imaginer un animal impossible qui a justement le cou d'une longueur invraisemblable ?
3 - L'explication psychanalytique :
Un psychanalyste allemand éminent, Herr Professor Hegebur, dans son ouvrage « Prolégomènes à l'introduction d'une approche de la connaissance de la girafe », fait observer très justement que le long cou de la girafe n'est autre qu'un symbole phallique. C'est là également une explication plausible du mythe de la girafe. On sait que c'est de la même façon qu'on a réfuté la naïve superstition de certains sauvages selon laquelle le suc du champignon penicillium notatum pouvait avoir une action curative sur les maladies. Ce champignon est de toute évidence un symbole phallique. L'existence d'un produit extrait du penicillium notatum appelé « pénicilline » et auquel on attribue des vertus curatives merveilleuses est, bien entendu, pure superstition.
Nous voyons ainsi que le mythe de la girafe peut parfaitement trouver son explication dans des considérations soit optiques, soit de physiologie, soit de psychanalyse. La méthode scientifique moderne n'aura pas de difficultés à démentir aussi les autres affirmations saugrenues d'excentriques dans le genre de Charles Fort.
Il est bien connu qu'il ne peut pas y avoir de faits qui n'aient été déjà décrits dans les nombreux et excellents ouvrages publiés par l'Union Rationaliste (16, rue de l'école Polytechnique). Tout fait non décrit dans ces ouvrages (apparitions dans le ciel, signaux mystérieux reçus par radio des espaces interstellaires, cancers des pare-brise, chutes de pierre) peut certainement être réduit à des illusions ou à des hallucinations collectives.
Signalons, pour terminer, un fait curieux qui montre à quel point la sagesse populaire rejoint la méthode scientifique. Un fermier américain à qui on avait montré un dessin représentant la prétendue girafe s'est écrié : « Il n'y a pas d'animal comme ça ! » N'est-ce point merveilleux de voir à quel point le gros bon sens populaire rejoint ainsi la rigueur de la méthode scientifique ?
Professeurs Pigafret et Galignol

Discussion